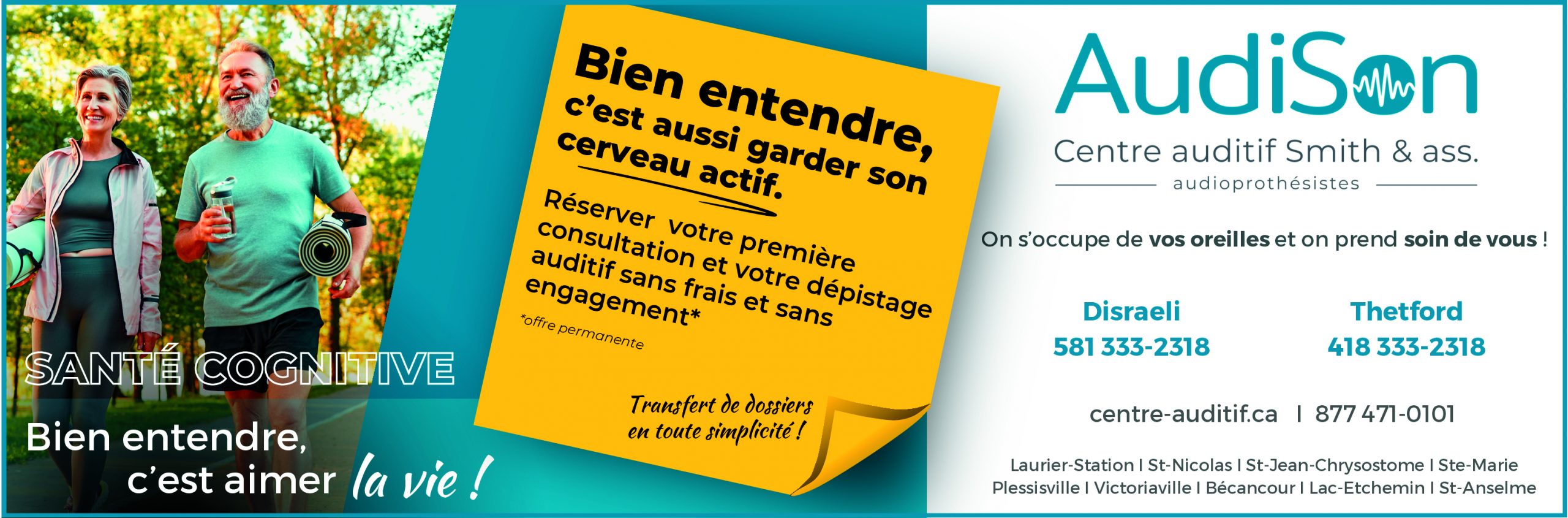Elle n’avait d’espagnol que le nom. À l’automne de 1918, une très mauvaise grippe s’installe et décime les populations. Les soldats de la Grande Guerre, qui n’est pas encore terminée, sont frappés par le mal et se demandent s’il ne s’agirait pas d’une nouvelle arme de l’ennemi : on muselle les médias. C’est en Espagne, pays neutre, qu’on évoque en premier l’ampleur de l’épidémie : dès lors, elle sera baptisée grippe « espagnole ».

Elle se répandra comme une traînée de poudre, en raison de l’intense trafic maritime et ferroviaire de cette fin de guerre où les soldats reviennent à la maison. Sans vaccins, presque sans médicaments ou antibiotiques et avec des mesures d’hygiène somme toute assez sommaires, en quelques mois, elle fera entre 50 et 100 millions de victimes, trois fois plus que la Grande Guerre elle-même. Le tiers de la population mondiale sera infecté. Au Canada, le conflit armé aura fait 60 000 victimes, selon le musée de la guerre, alors qu’on dénombre 50 000 victimes de la grippe. Au Québec, on estime qu’au moins 400 000 personnes tombent malades en 1918 et 14 000 perdent la vie, surtout des jeunes. Les forces vives sont touchées, la vie économique est perturbée, les hôpitaux submergés : on manque de médecins et d’infirmières. L’influenza laissera derrière lui des cimetières gonflés et des orphelins en grand nombre.
Plus près de nos régions, à Victoriaville plus précisément, un événement d’envergure mondiale semble avoir accéléré l’épidémie : le Congrès eucharistique. Des représentants arrivaient, de partout, pour prendre part aux célébrations qui ont débuté le 15 septembre et pas moins de 30 000 visiteurs se sont côtoyés de près, aussi bien à la procession qu’à la messe solennelle papale. Ainsi, en plus du retour des soldats démobilisés, des milliers de pèlerins contribuèrent à propager le virus.
Certains villages ont doublé leur taux de mortalité en 1918, comme à Saint-Ferdinand, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur, voire triplé comme à Saint-Julien. Les données des décès (toutes causes confondues), durant les mois d’août à décembre 1918, nous rapportent plus de 50 décès à Disraeli, 47 à Saint-Ferdinand, 26 à Saint-Julien, 15 à Beaulac-Garthby, 10 à Saint-Jacques-le-Majeur et tout de même plus de 200 à Thetford Mines, une des villes les plus touchées au Québec. En ce début de siècle, la guerre et ensuite la grippe auront ravagé les populations. Par exemple, selon le recensement de 1911 et pour le territoire de Disraeli, la population s’élevait à 2 344 personnes. Dix ans plus tard, on ne note presque aucune croissance, cette population n’atteignant que 2 438 personnes.
Mais cette violente grippe un peu mystérieuse, cette grande faucheuse, qui est-elle ? Ce n’est qu’en 2005 que les scientifiques ont réussi à identifier ce virus tueur : il s’agit d’un virus H1N1, un ancêtre de celui qui va nous frapper en 2009. Cela explique pourquoi les jeunes dans la force de l’âge furent les plus touchés. En effet, traditionnellement, ce sont les enfants et les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Or, entre 1880 et 1900, c’est un virus H3 qui a circulé dans le monde. Les enfants qui y ont été exposés sont devenus adultes en 1918 et face au virus H1, leur système immunitaire était démuni.
L’histoire nous rappelle durement l’importance de la prévention pour lutter contre le fléau de la grippe qui nous atteint l’automne venu. En novembre, la campagne de vaccination sera de retour, pensez-y… pour vous et vos proches.
En parcourant une liste de décès de la grippe espagnole, en cliquant ici, une pointe de tristesse nous atteint à la vue de noms qui nous semblent si familiers : les Roy, Grenier, Morin ou Gosselin…
Source : Québec Science ; Sociétés d’histoire et de généalogie de Disraeli, de Thetford Mines et de Victoriaville
- Ligne électrique vers Boston : Hydro-Québec frappée, mais toujours en ligne - 18 novembre 2021
- Lettre d’opinion : Une démocratie vivante - 18 novembre 2021
- Le bois de chauffage, écologique ? - 18 novembre 2021
 Le Cantonnier – Journal communautaire : Disraeli, Coleraine Un journal communautaire qui nous rassemble
Le Cantonnier – Journal communautaire : Disraeli, Coleraine Un journal communautaire qui nous rassemble