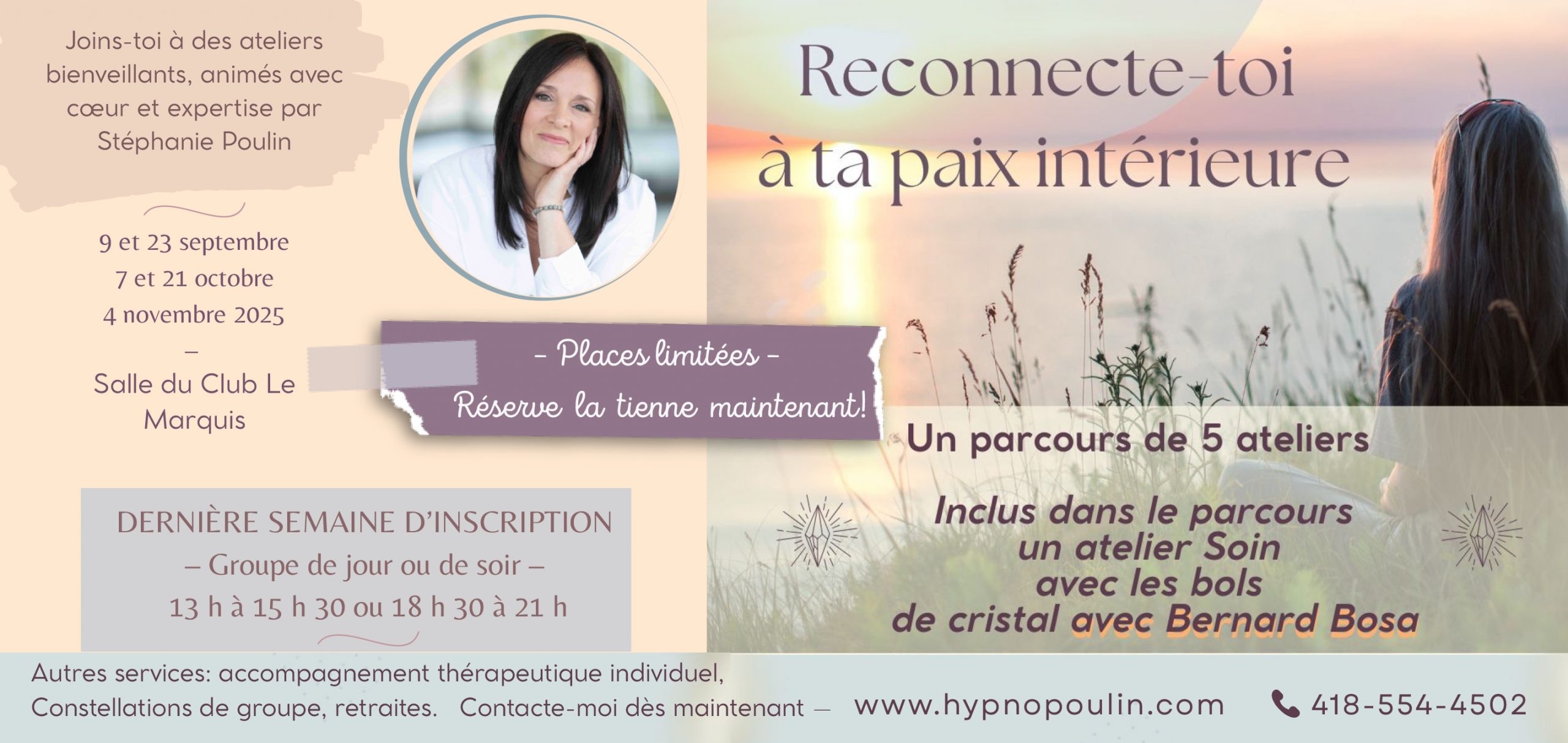Il est instructif de consulter les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui tiennent à jour un portrait assez détaillé de ce qui se passe avec la COVID-19. Depuis le mois de mars, les données s’accumulent pour nous permettre de dégager des faits solides au sujet de la pandémie. Attardons-nous à quelques données, compilées jusqu’au 9 novembre dernier, pour essayer de cerner l’essentiel.
Tout d’abord, le fait le plus tragique du Québec concerne le nombre de décès. Il totalise 6 493 personnes, décédées en très grande majorité (78 %) dans la grande région de Montréal. Elles résidaient principalement en Centre d’hébergement de soins de longue durée [CHSLD (61 %)] et en résidences pour aînés [RPA (17 %)]. Ainsi, sans surprise, les froides statistiques nous dévoilent que 92 % de ces décès sont survenus chez les personnes de 70 ans et plus ! Vous avez bien lu, 92 %, un peu plus de femmes que d’hommes. On ne nous a rien caché, pas de sombre complot, que des vies disparues qui nous avaient, jadis, donné la vie…

Qu’en est-il dans nos régions ? Les données brutes nous disent que seulement 86 personnes en Chaudière-Appalaches et 47 en Estrie se retrouvent dans ce triste bilan des décès québécois ; on est épargné, me direz-vous, car les données régionales semblent nous porter bien loin du drame montréalais. Les choses ne sont pas si simples. On se rappelle qu’en première vague le virus était bien peu présent dans nos régions. Et puis, voilà qu’en deuxième vague Chaudière-Appalaches est dans le rouge et certains coins du Granit surchauffent. Pour y voir plus clair, il faut comparer des régions aux populations différentes en utilisant les chiffres du nombre de cas actifs par 100 000 personnes : c’est ce taux qui nous révèle la gravité de la situation actuelle.
En effet, si l’Estrie a un taux de cas actifs de 107 pour 100 000 personnes, Le Granit en affiche un de 332. De même, en Chaudière-Appalaches, le taux est de 128, mais il a monté à 242 en octobre autour de Thetford Mines, pour redescendre maintenant à 136. Ces taux ont dépassé, et de loin, ceux de Montréal (122) ou de la Capitale-Nationale (110), ces foyers si gravement touchés. Cela veut dire que la COVID est maintenant très présente et qu’elle circule beaucoup, beaucoup trop et dangereusement dans nos régions.
Que faire ? En attendant le vaccin et les médicaments salvateurs, y a-t-il un remède ? Oui, il faut rester vigilant, respecter les consignes et ne pas lâcher : se laver les mains, porter le couvre-visage, respecter les deux mètres de distanciation et ne pas se rassembler. Ce faisant, on contribue à diminuer la propagation du virus et le nombre de cas actifs… et de vies perdues. Il est encourageant de voir que les gens comprennent et respectent les mesures. Le Devoir, dans son édition du 29 octobre, nous indiquait que « plus de 75 % des Québécois adhèrent aux mesures imposées par le gouvernement pour limiter la propagation de la COVID-19, selon des données de l’INSPQ. […] La majorité des Québécois suivent les recommandations du mieux qu’ils le peuvent, et l’appel à rehausser de prudence a été entendu. »
Malgré cela, le virus court et court encore. Alors, serrons-nous les dents, serrons-nous les masques et maintenons la pression solidaire, car c’est tous ensemble que nous arriverons à endiguer la propagation de ce virus. Pour en savoir plus : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees.
- Ligne électrique vers Boston : Hydro-Québec frappée, mais toujours en ligne - 18 novembre 2021
- Lettre d’opinion : Une démocratie vivante - 18 novembre 2021
- Le bois de chauffage, écologique ? - 18 novembre 2021
 Le Cantonnier – Journal communautaire : Disraeli, Coleraine Un journal communautaire qui nous rassemble
Le Cantonnier – Journal communautaire : Disraeli, Coleraine Un journal communautaire qui nous rassemble